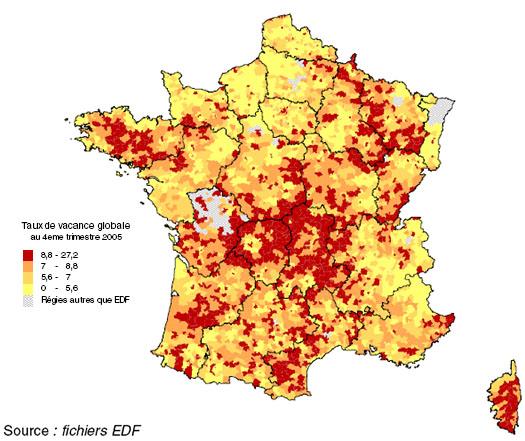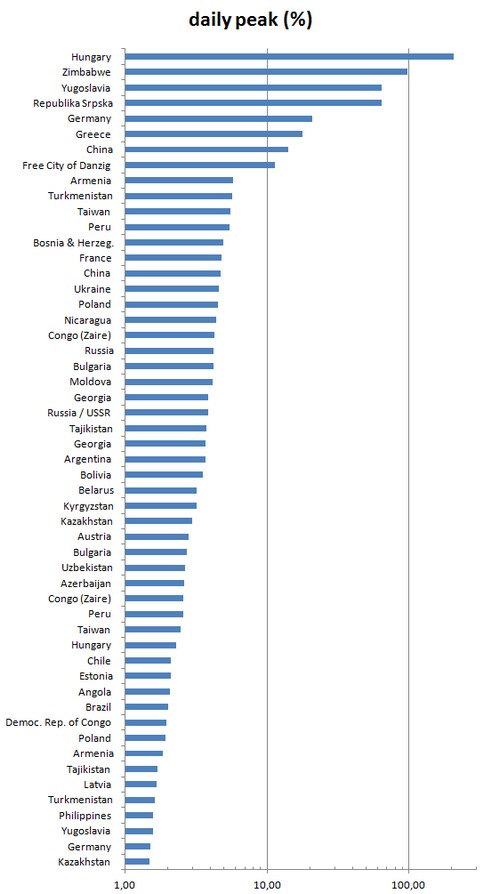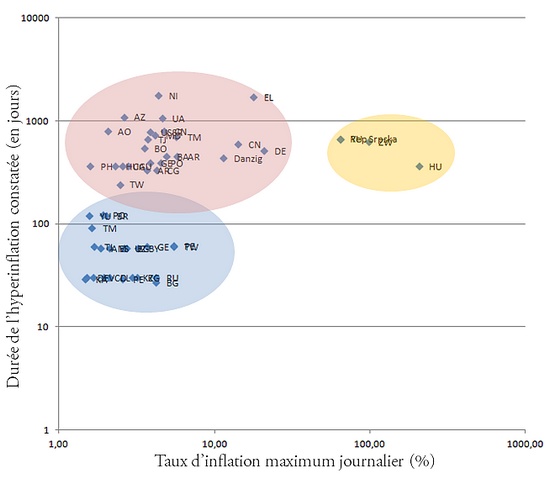On s’interroge souvent sur les effets d'une éventuelle sortie de Grèce de la zone euro. Serait-ce positif ou négatif ?
Ce débat reste assez
idéologique en fait. On croit souvent que le fait d’être plutôt
favorable à une sortie de la Grèce de la zone euro, cela signifie nécessairement que l’on est
contre l’Europe. Très souvent, les
eurosceptiques ne sont pas contre l’Europe mais
pour une autre Europe ainsi qu’une autre monnaie unique avec des institutions sociales-démocrates. L’euro aurait davantage
exacerbé les divergences économiques qu’assuré une quelconque
convergence même non homogène.
À partir de là, il est possible d’évaluer le
coût d’opportunité, c'est-à-dire le
coût de renonciation à la zone euro. Il est possible de justifier économiquement une sortie de la zone euro au-delà des
aspects politiques et psychologiques. Comparons les
gains et les coûts de plusieurs scénarios possibles.
Première situation : le maintien de la Grèce dans la zone euro
Concernant les
gains pour la zone euro du maintien de la Grèce dans la zone euro (A) : Il se résume aujourd’hui aux
effets bénéfiques d’une politique de change inexistante, mais ces effets bénéfiques ont déjà bien été absorbés par les
marchés si l’on peut dire les choses ainsi… Ces gains sont forts certes sur le plan
symbolique, et dans l’histoire de la construction européenne, et dans le domaine du
psychologique, élément essentiel au fonctionnement des
marchés financiers.
On peut ajouter quand même les gains
économiques passés liés au
rattrapage opéré par les pays du Sud en matière de croissance économique pendant les premières années de la décennie
2000,
l’amélioration des niveaux de vie, la qualité de beaucoup d’autres
aspects de la vie quotidienne. Ces gains, d’ailleurs, semblent assez
indépendants de l’existence de la Grèce dans la zone euro. On peut librement ici ajouter d’autres gains.
Concernant les
coûts pour la zone euro du maintien de la Grèce dans la zone euro (B) : Le maintien de la Grèce dans la zone euro a un coût assez
visible. Évidemment, tous les plans de
sauvetage depuis le début de la crise et une situation de
puit sans fond où pour la Grèce, les
taux d’intérêt à dix ans sont toujours très supérieurs aux taux de croissance. Il faut ajouter à cela les coûts des politiques
d’austérité réalisées en même temps et qui ponctionnent la
croissance, politiques initialisées par la Grèce en premier lieu faut-il le rappeler avec un effet de
contagion politique.
Enfin, les
coûts sociaux bien visibles, si l’on
considère que le cas de la Grèce a propulsé un certain nombre de choses
en Europe… Il faut ajouter un vrai
risque systémique facilement compréhensible par la méthode médicale. Comme la «
cellule malade » est dans la zone, elle risque de
contaminer les autres. D’ailleurs, le principe du
défaut déguisé entre dans cette catégorie puisque les
décotes des créanciers sur la dette grecque ont bien été effectives et mises à exécution.
Concernant les gains pour la Grèce du maintien de la Grèce dans la zone euro (C) :
Appelons les C : Ici, entre le principe de l’
aléa moral. Quel est l’intérêt de la Grèce de respecter certains
critères si elle considère que, de toute façon, les autres pays de la zone
paieront. Ensuite, elle bénéficie aussi d’un
espace commercial de qualité et compétitif qui lui permet de satisfaire l’ensemble des besoins de la population à des
conditions intra-branches avantageuses. D’autres gains peuvent être ajoutés. Par exemple, étant un pays plus risqué en matière
d’investissement, elle a pu réussir à attirer des investisseurs internationaux
preneurs de risques.
Concernant les coûts pour la Grèce de son maintien dans la zone euro (D) :
Les coûts représentent la
quote-part de la Grèce à l’ensemble des ressources du
FESF. On peut ajouter bien sûr le
coût économique pour la Grèce des
divergences économiques accentuées ces derniers temps notamment par rapport aux
pays du Nord. Cette liste non exhaustive peut s’étendre.
Seconde situation (hypothétique celle-ci) : sortie de la Grèce de la zone euro
Concernant maintenant les
gains pour la zone euro sans la Grèce (E) : ici, on retrouve l’
arrêt du risque systémique et la possibilité le cas échéant de
mobiliser des capitaux vers des pays
récupérables, c’est-à-dire lorsque le différentiel «
taux d’intérêt à 10 ans – taux de croissance économique » est le plus faible possible pour simplifier.
Concernant maintenant les
coûts pour la zone euro sans la Grèce (F) : objectivement, il est
difficile de dire que l’absence de la Grèce soit une catastrophe pour l’économie européenne. Sur le plan strictement économique - et les chiffres ont été donnés -, le
poids de la Grèce dans la zone euro est très
faible et la Grèce n’est pas une
plateforme de propulsion de l’économie européenne vers d’autres zones géographiques, les
échanges en zone euro étant essentiellement
intra-branches. Ici, l’inquiétude est surtout le
défaut du coup total et non déguisé de la Grèce vis-à-vis de ses
créanciers et le risque d’une
décote encore plus élevée.
Concernant les gains pour la Grèce de sa sortie de la zone euro (G) :
Ici, il faut raisonner en deux temps, et l’on oublie bien
volontairement le second temps, en général au bout de six mois (cas de
nombreux pays qui ont décroché d’une zone à ancrage monétaire et qui ont
dévalué). L’économie est caractérisée par des
cycles. Ici, dans les commentaires et pour le cas d’une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro, il n’existerait plus de cycle.
Certes une
récession encore plus profonde est possible avec
exclusion du financement des marchés financiers à cause du
défaut probable officiel, mais une récession s’accompagne toujours d’une
stabilisation et d’une
reprise économique au bout de 6 mois après la sortie de la zone d’ancrage monétaire (
reprise de la production, diversification de l’activité, reprise en main des affaires publiques…). Cette reprise économique est permise par des politiques économiques appropriées et non auto-suicidaires. Les
indépendances monétaire et budgétaire en somme.
Concernant les
coûts pour la Grèce de sa sortie de
la zone euro (H) : on dit que si la Grèce sort de la zone euro, il
existe plusieurs types de coûts : d’abord, une
inflation importée, une
baisse considérable du pouvoir d’achat des Grecs, l’
explosion de la dette en euro suite à une forte
dévaluation du drachme (pas évidente puisque une part importante de la dette publique grecque est de droit privé national).
On évoque aussi souvent le
risque systémique en oubliant que de toute façon celui-ci existe déjà dans la zone euro. Admettons alors la
contagion. Remarquons que la métaphore médicale ne permet pas de valider l’assertion car, lorsqu’une «
cellule malade » est enlevée, on comprend moins l’idée de contagion, et comment celle-ci peut avoir lieu lorsque la
dette nationale est détenue par des nationaux. En revanche, à l’intérieur de la zone euro, celle-ci existe réellement.
Conclusion :
À la différence des coûts et gains du maintien de la Grèce dans la zone euro,
les
coûts et gains d’une sortie de la Grèce de la zone euro sont des
estimations tournées vers le futur et extrêmement aléatoires alors que
les coûts et les gains de la Grèce dans la zone euro, eux, peuvent plus
facilement être estimés. Du coup, les coûts et gains tirés d’une situation
hypothétique de sortie de la Grèce doivent être actualisés par un « discount factor », un
taux d’intérêt de référence pour
ramener ces montants à leur valeur présente. Cette liste n’est bien
évidemment pas exhaustive, libre à chacun d’y intégrer des éléments
économiques, mais au final une sortie de la Grèce de la zone euro
est-elle bénéfique ?
Dans l’hypothèse où il est possible de déterminer un coût du capital, un discount rate ou
encore un taux d’actualisation, alors le maintien de la Grèce est
préférable si (A+C) – (B+D) non actualisée > (E+G) – (F+H)
actualisées.
|
Maintien de la Grèce dans la zone euro |
Sortie de la Grèce dans la zone euro |
|
GAINS |
COÛTS |
GAINS |
COÛTS |
| Pour la zone euro |
A
|
B
|
E
|
F
|
| Pour la Grèce |
C
|
D
|
G
|
H
|